 |
Afghanistan |  |
 |
Afghanistan |  |
Kandahar - Le 15 novembre 1996
Kandahar : Des Talibans à l'état « brutes »
| Kaboul découvre avec effarement la loi islamiste que veulent imposer ses nouveaux maîtres, les Talibans, une armée de moines soldats surgie des campagnes du sud du pays, dont l'ambition est d'instaurer un Etat purement islamique sur les ruines de l'Afghanistan. A 450 kilomètres de là, des centaines de milliers d'hommes et de femmes vivent depuis deux années déjà sous la coupe de cette faction fondamentaliste, à Kandahar, proclamée capitale des Talibans en novembre 1995. Les enragés d'Allah y jouent depuis aux apprentis sorciers de la politique. Au nom d'un Islam des plus purs. Des plus durs, aussi. |  |
 a route est droite.
Désespérément droite. Et défoncée. Le 4x4 de
l'organisation humanitaire Handicap International a route est droite.
Désespérément droite. Et défoncée. Le 4x4 de
l'organisation humanitaire Handicap International  vient de passer le poste
frontière de Chaman, première ville en Afghanistan, un
pays ravagé par dix-sept années de guerre. Il faudrait
être aveugle pour l'oublier. Partout, les cicatrices de
la guerre s'étalent, béantes. Ici, le cadavre d'un
cheval blanc qui a sauté sur une mine. Là, un pont mal
rafistolé, défoncé en son milieu par un énorme
cratère. Bombe, roquette ou mine ? La route elle-même
n'en est plus une, vague piste de poussière et de
cratère, entrecoupée ça et là par quelques traces de
goudron, maigre réminiscence des infrastructures du
temps de l'occupation soviétique. Des paysages
somptueux, vastes plaines dorées d'où émergent
brutalement un tank brûlé, laid squelette d'acier, un
ancien immeuble militaire défoncé... Les Soviétiques
n'ont pas réussi à mettre au pas l'Afghanistan. Les
115.000 soldats s'en sont allés en 1989, laissant
derrière eux tous les signes de la débâcle. Et un pays
ravagé, déchiré maintenant par les combats fratricides
des factions moudjahidins qui s'entre-tuent à leur tour
pour le contrôle d'un pauvre territoire ruiné. vient de passer le poste
frontière de Chaman, première ville en Afghanistan, un
pays ravagé par dix-sept années de guerre. Il faudrait
être aveugle pour l'oublier. Partout, les cicatrices de
la guerre s'étalent, béantes. Ici, le cadavre d'un
cheval blanc qui a sauté sur une mine. Là, un pont mal
rafistolé, défoncé en son milieu par un énorme
cratère. Bombe, roquette ou mine ? La route elle-même
n'en est plus une, vague piste de poussière et de
cratère, entrecoupée ça et là par quelques traces de
goudron, maigre réminiscence des infrastructures du
temps de l'occupation soviétique. Des paysages
somptueux, vastes plaines dorées d'où émergent
brutalement un tank brûlé, laid squelette d'acier, un
ancien immeuble militaire défoncé... Les Soviétiques
n'ont pas réussi à mettre au pas l'Afghanistan. Les
115.000 soldats s'en sont allés en 1989, laissant
derrière eux tous les signes de la débâcle. Et un pays
ravagé, déchiré maintenant par les combats fratricides
des factions moudjahidins qui s'entre-tuent à leur tour
pour le contrôle d'un pauvre territoire ruiné. |
 |
La route sent la désespérance des pays brisés. Seuls des barbelés et des pierres rouges en coupent la monotonie et indiquent le danger. Au-delà de ces remparts dérisoires, des champs de mines. L'Afghanistan est aujourd'hui l'un des trois pays les plus minés au monde. La guerre qui succède à la guerre ne suffit donc pas. Les spécialistes annoncent aujourd'hui qu'il faudra près de cinquante années pour nettoyer le terrain. En attendant, gamins, nomades, récupérateurs de métaux, paysans, démineurs parfois sautent par milliers sur les mines (voir carnet suivant). La population est épuisée, désespérée, mais continue pourtant de rêver à la paix. Un jour peut-être... |
Kandahar, capitale des enragés de l'Islam
Justement, au bout de la route, à Kandahar, on
goûte à la paix. Une drôle de paix, instaurée par des
enragés de l'Islam. 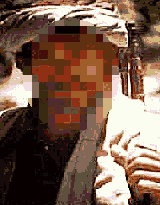 Les
Talibans, qui contrôlent aujourd'hui plus ou moins les
deux-tiers du pays. Les « moines soldats »,
comme on les appelle en Europe, sont arrivés en
conquérants dans la plus grosse ville du sud du pays en
novembre 1995. Ancienne capitale royale, dont la mosquée
referme, dit-on, le manteau du prophète Mahomet,
Kandahar a été immédiatement proclamée capitale des
Talibans. Elle est devenue le berceau du mouvement.
Pacifiée par la faction islamiste, elle est aussi
aujourd'hui l'une des villes les plus sûres du pays.
Issus des campagnes les plus profondes du sud du pays,
« une armée de ploucs » comme certains
journalistes s'amusent à les définir, les Talibans
jouent aujourd'hui aux apprentis sorciers de la
politique. A Kandahar, ils ont installés leurs
« ministères », drôles de bâtiments
poussiéreux, meublés à la hâte et encombrés de
lance-flammes rouillés, de kalashnikovs négligées, de
poules et de reliefs de repas, où des barbus
enturbannés, devenus « ministres » du jour
au lendemain, concoctent avec le plus grand sérieux les
décrets talibans qu'ils veulent fermement imposer au
reste du pays. Du fondamentalisme à l'état le plus
brut, du jamais vu : interdiction du travail des femmes,
fermeture des écoles pour filles, obligation du port de
la barbe et du turban pour les hommes, femmes dûment
encagées dans des voiles intégraux qui ne laissent
qu'une grille au niveau des yeux, obligation de prier
cinq fois par jour, interdiction de la photographie, de
la musique, des jeux de hasard, des jeux d'échecs, de la
danse, de la poésie... Les
Talibans, qui contrôlent aujourd'hui plus ou moins les
deux-tiers du pays. Les « moines soldats »,
comme on les appelle en Europe, sont arrivés en
conquérants dans la plus grosse ville du sud du pays en
novembre 1995. Ancienne capitale royale, dont la mosquée
referme, dit-on, le manteau du prophète Mahomet,
Kandahar a été immédiatement proclamée capitale des
Talibans. Elle est devenue le berceau du mouvement.
Pacifiée par la faction islamiste, elle est aussi
aujourd'hui l'une des villes les plus sûres du pays.
Issus des campagnes les plus profondes du sud du pays,
« une armée de ploucs » comme certains
journalistes s'amusent à les définir, les Talibans
jouent aujourd'hui aux apprentis sorciers de la
politique. A Kandahar, ils ont installés leurs
« ministères », drôles de bâtiments
poussiéreux, meublés à la hâte et encombrés de
lance-flammes rouillés, de kalashnikovs négligées, de
poules et de reliefs de repas, où des barbus
enturbannés, devenus « ministres » du jour
au lendemain, concoctent avec le plus grand sérieux les
décrets talibans qu'ils veulent fermement imposer au
reste du pays. Du fondamentalisme à l'état le plus
brut, du jamais vu : interdiction du travail des femmes,
fermeture des écoles pour filles, obligation du port de
la barbe et du turban pour les hommes, femmes dûment
encagées dans des voiles intégraux qui ne laissent
qu'une grille au niveau des yeux, obligation de prier
cinq fois par jour, interdiction de la photographie, de
la musique, des jeux de hasard, des jeux d'échecs, de la
danse, de la poésie... |
 Et pourtant, la
population n'est pas si désespérée. Là où l'on
attendait plaintes et larmes, on trouve des témoignages
nuancés : « Les conditions instaurées par les
Talibans sont très dures. Mais ils ont pacifié et
désarmé la ville. Nous venons de traverser les quatre
années les plus noires de notre vie. Les factions
moudjahidins se battaient pour le contrôle de la ville.
Il n'y avait plus de loi. On ne pouvait plus sortir sans
craindre d'être enlevées, violées ou blessées par une
balle perdue. Aujourd'hui, nous pouvons ressortir en
toute sécurité » confie Azor, une ancienne
professeur d'anglais aujourd'hui au chômage
idéologique. Comme elles, toutes les femmes rencontrées
se félicitent de la paix retrouvée. Pourtant, elles
l'ont payé au prix fort : celui de leur liberté. Car à
Kandahar, fief taliban, tous les décrets inspirés de la
charia, la loi islamique interprétée de la manière la
plus rigoriste, sont ici appliqués par la milice de
façon plus ferme qu'ailleurs. Question d'image. Manière
aussi de bien montrer qui règne en maître sur la ville
depuis deux ans. Et pourtant, la
population n'est pas si désespérée. Là où l'on
attendait plaintes et larmes, on trouve des témoignages
nuancés : « Les conditions instaurées par les
Talibans sont très dures. Mais ils ont pacifié et
désarmé la ville. Nous venons de traverser les quatre
années les plus noires de notre vie. Les factions
moudjahidins se battaient pour le contrôle de la ville.
Il n'y avait plus de loi. On ne pouvait plus sortir sans
craindre d'être enlevées, violées ou blessées par une
balle perdue. Aujourd'hui, nous pouvons ressortir en
toute sécurité » confie Azor, une ancienne
professeur d'anglais aujourd'hui au chômage
idéologique. Comme elles, toutes les femmes rencontrées
se félicitent de la paix retrouvée. Pourtant, elles
l'ont payé au prix fort : celui de leur liberté. Car à
Kandahar, fief taliban, tous les décrets inspirés de la
charia, la loi islamique interprétée de la manière la
plus rigoriste, sont ici appliqués par la milice de
façon plus ferme qu'ailleurs. Question d'image. Manière
aussi de bien montrer qui règne en maître sur la ville
depuis deux ans. |
Retour à l'âge d'or islamique
La région, de culture traditionaliste et tribale,
souffre cependant certainement moins que Kaboul la
libérale de toutes ces mesures, notamment celles qui
concernent les femmes. 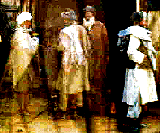 « Dans la culture de cette région, les décrets
talibans ne sont pas dénués de tout sens. Ici, les
femmes étaient souvent l'objet des guerres tribales,
victimes d'enlèvements et de viols... Les garder à la
maison, c'était alors les protéger » analyse
Nawid, cadre supérieur qui a accepté de témoigner sous
un faux prénom. Réfugié du nord du pays, il analyse et
tente de comprendre. Mais il critique aussi sans
complaisance : « Le problème, c'est que nous ne
sommes plus à l'âge de pierre. Et que les Talibans
voudraient nous forcer à y retourner ». Et, ici,
plus personne n'a le choix. A l'école même, les
garçons sont obligés de porter le turban, de lire les
textes saints qui appellent au Jihad, de porter la barbe
dès que trois poils apparaissent sur le menton. La
référence de base à Kandahar : le septième siècle de
notre ère, époque du Prophète Mahomet, celui qui reçu
la parole de Dieu et fut à l'origine de la religion
islamique.
« Dans la culture de cette région, les décrets
talibans ne sont pas dénués de tout sens. Ici, les
femmes étaient souvent l'objet des guerres tribales,
victimes d'enlèvements et de viols... Les garder à la
maison, c'était alors les protéger » analyse
Nawid, cadre supérieur qui a accepté de témoigner sous
un faux prénom. Réfugié du nord du pays, il analyse et
tente de comprendre. Mais il critique aussi sans
complaisance : « Le problème, c'est que nous ne
sommes plus à l'âge de pierre. Et que les Talibans
voudraient nous forcer à y retourner ». Et, ici,
plus personne n'a le choix. A l'école même, les
garçons sont obligés de porter le turban, de lire les
textes saints qui appellent au Jihad, de porter la barbe
dès que trois poils apparaissent sur le menton. La
référence de base à Kandahar : le septième siècle de
notre ère, époque du Prophète Mahomet, celui qui reçu
la parole de Dieu et fut à l'origine de la religion
islamique. |
 Les Talibans, qui
n'ont absolument aucune expérience de gouvernement,
commencent cependant à réfléchir. Sous la pression de
deux organisations humanitaires, Handicap International
et le Comité international de la Croix-Rouge, ils ont
ainsi consenti à ce que des femmes afghanes, une
poignée, soient employées dans les secteurs médical et
paramédical : Les Talibans, qui
n'ont absolument aucune expérience de gouvernement,
commencent cependant à réfléchir. Sous la pression de
deux organisations humanitaires, Handicap International
et le Comité international de la Croix-Rouge, ils ont
ainsi consenti à ce que des femmes afghanes, une
poignée, soient employées dans les secteurs médical et
paramédical :  « Le deal était simple. S'ils voulaient que nous
les aidions à mettre en place un hôpital, la condition
était de soigner les hommes comme les femmes. Dans la
logique talibane, hommes et femmes qui ne sont pas de la
même famille ne doivent avoir aucun contact.
« Le deal était simple. S'ils voulaient que nous
les aidions à mettre en place un hôpital, la condition
était de soigner les hommes comme les femmes. Dans la
logique talibane, hommes et femmes qui ne sont pas de la
même famille ne doivent avoir aucun contact.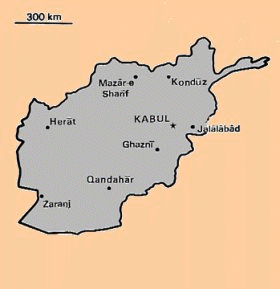 Il fallait donc que
des femmes travaillent pour soigner les femmes. »
explique l'un des responsables du Comité international
de la Croix-Rouge. Les Talibans ont fait bien des efforts
pour faire capoter le projet : pressions psychologiques,
blocage des bus chargés d'acheminer les femmes afghanes
sur le lieu de travail et même arrestations de certaines
d'entre-elles. La lutte fut difficile. Mais les maîtres
de Kandahar ont finalement plié. « Certains
voudraient couper toutes les aides en pays taliban, au
nom du droit des femmes. Or, si nous partons, qui fera
prendre conscience aux Talibans de leurs propres
contradictions? Les femmes, comme les hommes, ont ici
besoin de notre aide, plus que jamais... » Car il
ne faudrait pas oublier que ce sont « près d'un
demi-million de réfugiés ont choisi de revenir habiter
dans la zone depuis que les Talibans ont pacifié la
zone » selon le Haut commissariat aux réfugiés
pour la province de Kandahar. Autant de personnes qui
savent aujourd'hui que la paix en Afghanistan à un prix
: celui de la liberté. Après dix-sept années de
guerre, ils sont des centaines de milliers à avoir
choisi de le payer. Il fallait donc que
des femmes travaillent pour soigner les femmes. »
explique l'un des responsables du Comité international
de la Croix-Rouge. Les Talibans ont fait bien des efforts
pour faire capoter le projet : pressions psychologiques,
blocage des bus chargés d'acheminer les femmes afghanes
sur le lieu de travail et même arrestations de certaines
d'entre-elles. La lutte fut difficile. Mais les maîtres
de Kandahar ont finalement plié. « Certains
voudraient couper toutes les aides en pays taliban, au
nom du droit des femmes. Or, si nous partons, qui fera
prendre conscience aux Talibans de leurs propres
contradictions? Les femmes, comme les hommes, ont ici
besoin de notre aide, plus que jamais... » Car il
ne faudrait pas oublier que ce sont « près d'un
demi-million de réfugiés ont choisi de revenir habiter
dans la zone depuis que les Talibans ont pacifié la
zone » selon le Haut commissariat aux réfugiés
pour la province de Kandahar. Autant de personnes qui
savent aujourd'hui que la paix en Afghanistan à un prix
: celui de la liberté. Après dix-sept années de
guerre, ils sont des centaines de milliers à avoir
choisi de le payer. |
(Note Du Photographe : Au "Talibistan", les photographies de "choses vivantes" sont interdites. Pour cette raison, certaines images sont masquées. De plus, il n'était pas évident de sortir notre Chinon ES-3000, très performant, mais pas vraiment discret pour voler des images. Nous avons réalisé la plupart des photographies avec un Nikon négligemment porté autour du cou. Les photos numériques étaient moins évidentes à réaliser. Nous espérons que vous nous en excuserez.