

 |
Singapour |  |
Singapour, le 15 février 1997
Singaporama
 |
L'ordre et la propreté ? L'hyper organisation ? La folie du shopping ? Que retenir de Singapour ? A trop se balader dans les artères commerçantes, on en oublierait presque la vie des banlieues impeccables où se concentrent la vie de la majorité des Singapouriens. Derrière la vitrine technologique d'une cité qui semble avoir été conçue par ordinateur, on découvre aussi une population colorée et joyeuse. |  |
 La petite
colonie pauvre devenue l'un des états les plus riches
d'Asie. Figé à jamais dans l'albâtre de sa
statue, Sir Stamford Raffles a une vue imprenable sur une
forêt de gratte-ciel, tous plus orgueilleux et opulents
les uns que les autres... En 1819, l'Anglais avait
pourtant mis le pied sur une petite île sauvage et
tropicale, règne des pythons et des mygales. Singapour,
la " cité du Lion " ne semblait
alors vraiment pas mériter son surnom. Se développant
avec peine dans les décennies qui ont suivies, le petit
port de pêche de la mer de Chine n'était qu'une ville
pauvre, grouillante et urbanisée dans la hâte et la
tôle ondulée des bidonvilles. Une petite ville perdue
sur un îlot du bout du cul de l'Asie. Le 9 août 1965,
à l'heure de l'indépendance, qui aurait pu parier sur
la spectaculaire croissance de ce nouvel Etat, coincé
sur ses 616 km2 ? Le nouveau gouvernement inventa
cependant un nouveau modèle de développement, fondé
sur l'appel illimité aux capitaux étrangers, aux
multinationales et aux exportations. Le PNB se mit à
croître de 10% par an, Singapour s'imposa comme l'un des
centres financiers d'Asie. Et bientôt, la petite cité
se hissa au rang de la deuxième nation la plus riche
d'Asie, juste derrière le Japon. En 1995, le PNB par
habitant a atteint les 125.000 FF par an, dépassant
même celui de la France. La petite
colonie pauvre devenue l'un des états les plus riches
d'Asie. Figé à jamais dans l'albâtre de sa
statue, Sir Stamford Raffles a une vue imprenable sur une
forêt de gratte-ciel, tous plus orgueilleux et opulents
les uns que les autres... En 1819, l'Anglais avait
pourtant mis le pied sur une petite île sauvage et
tropicale, règne des pythons et des mygales. Singapour,
la " cité du Lion " ne semblait
alors vraiment pas mériter son surnom. Se développant
avec peine dans les décennies qui ont suivies, le petit
port de pêche de la mer de Chine n'était qu'une ville
pauvre, grouillante et urbanisée dans la hâte et la
tôle ondulée des bidonvilles. Une petite ville perdue
sur un îlot du bout du cul de l'Asie. Le 9 août 1965,
à l'heure de l'indépendance, qui aurait pu parier sur
la spectaculaire croissance de ce nouvel Etat, coincé
sur ses 616 km2 ? Le nouveau gouvernement inventa
cependant un nouveau modèle de développement, fondé
sur l'appel illimité aux capitaux étrangers, aux
multinationales et aux exportations. Le PNB se mit à
croître de 10% par an, Singapour s'imposa comme l'un des
centres financiers d'Asie. Et bientôt, la petite cité
se hissa au rang de la deuxième nation la plus riche
d'Asie, juste derrière le Japon. En 1995, le PNB par
habitant a atteint les 125.000 FF par an, dépassant
même celui de la France.  Grâce
à une ambitieuse politique gouvernementale, 88% des
habitants sont propriétaires de leurs logements, un
record mondial. Singapour n'en finit plus d'aligner les
records. Du jamais vu aussi, la stabilité politique du
parti dominant, le People's Action Party (PAP) au pouvoir
depuis l'indépendance. Les Singapouriens l'ont payé au
prix fort : pas de syndicats, pas de droit de grève, pas
d'allocation chômage, pas de presse libre, pas d'accès
aux télévisions étrangères et la sévère mise au pas
de tous les opposants au régime. La " cité du
Lion " porte désormais si bien son nom qu'elle
sait même parfois adopter des comportements de
prédateur. Grâce
à une ambitieuse politique gouvernementale, 88% des
habitants sont propriétaires de leurs logements, un
record mondial. Singapour n'en finit plus d'aligner les
records. Du jamais vu aussi, la stabilité politique du
parti dominant, le People's Action Party (PAP) au pouvoir
depuis l'indépendance. Les Singapouriens l'ont payé au
prix fort : pas de syndicats, pas de droit de grève, pas
d'allocation chômage, pas de presse libre, pas d'accès
aux télévisions étrangères et la sévère mise au pas
de tous les opposants au régime. La " cité du
Lion " porte désormais si bien son nom qu'elle
sait même parfois adopter des comportements de
prédateur. |
Une cité multiculturelle. Lorsque
Sir Stamford Raffles installa la colonie britannique à
Singapour, les Chinois des provinces du sud affluèrent,
attirés par la perspective de développement.
Aujourd'hui, Singapour garde encore  les traces de cette forte
émigration. La ville-Etat, forte de trois millions
d'habitants, est composée de 75% de Chinois, 15% de
Malais et 7% d'Indiens. Singapour se targue volontiers de
cette diversité ethnique. Mais le petit Etat, convaincu
d'être menacé par ses plus grands voisins (la Malaisie,
l'Indonésie, la Thaïlande...), semble surtout obsédé
par une éventuelle brèche dans le sacro-saint principe
de l'unité nationale. Dès l'école primaire, les
enfants sont bombardés de cours de " bons
citoyens ". Un rapport affolé du ministère de
l'Education expliquait, en septembre dernier, que la
majorité des élèves ne connaissaient que très mal
l'histoire de leur nation... Les professeurs furent
immédiatement priés d'y remédier. Afin de conserver
l'équilibre ethnique, le gouvernement veille
soigneusement au respect des quotas dans les différents
quartiers. Et rappelle sans cesse à ses citoyens les
vertus du confucianisme, l'un des éléments-clés du
modèle à la singapourienne : le fils obéit au père,
l'élève au maître, le gouverné au gouvernant... les traces de cette forte
émigration. La ville-Etat, forte de trois millions
d'habitants, est composée de 75% de Chinois, 15% de
Malais et 7% d'Indiens. Singapour se targue volontiers de
cette diversité ethnique. Mais le petit Etat, convaincu
d'être menacé par ses plus grands voisins (la Malaisie,
l'Indonésie, la Thaïlande...), semble surtout obsédé
par une éventuelle brèche dans le sacro-saint principe
de l'unité nationale. Dès l'école primaire, les
enfants sont bombardés de cours de " bons
citoyens ". Un rapport affolé du ministère de
l'Education expliquait, en septembre dernier, que la
majorité des élèves ne connaissaient que très mal
l'histoire de leur nation... Les professeurs furent
immédiatement priés d'y remédier. Afin de conserver
l'équilibre ethnique, le gouvernement veille
soigneusement au respect des quotas dans les différents
quartiers. Et rappelle sans cesse à ses citoyens les
vertus du confucianisme, l'un des éléments-clés du
modèle à la singapourienne : le fils obéit au père,
l'élève au maître, le gouverné au gouvernant... |
La fête des vacances. Le
multiculturalisme à la singapourienne enchante les
écoliers. Quand en France, on n'a qu'un seul Noël, à
Singapour, les fêtes se multiplient. Et les vacances,
pourtant rares dans la cité-Etat, se doublent aussi.
Aucune communauté ne sera désavantagée par rapport à
l'autre : aux Chinois leur nouvelle année, aux Indiens
musulmans et aux Malais  leur
fin de Ramadan (Hari Raya). Cette année, les deux
grandes fêtes -les plus importantes de l'année- sont
tombées en même temps. leur
fin de Ramadan (Hari Raya). Cette année, les deux
grandes fêtes -les plus importantes de l'année- sont
tombées en même temps.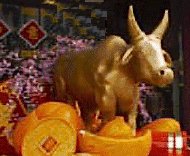 Little
India s'est parée de mille décorations, des myriades de
lampions ont poussé dans les rues de Chinatown. Inutile
cependant d'attendre de grandes festivités publiques,
tout se passe à la maison. Les Chinois échangent les
oranges, symbole de la prospérité. Le soir de Nouvel
An, quelques uns tirent des feux d'artifices, d'autres
multiplient les offrandes à la mémoire de leurs
ancêtres, d'autres encore font brûler les bâtonnets
d'encens. Les danses du dragon, rythmées par les
tambours, résonnent dans les échoppes de rue. Les
vaches, symbole de l'année, fleurissent partout. Les
Indiens et les Malais se réunissent de leur côté pour
de grands repas qui célèbrent la fin des quarante jours
de jeûne. Des prières collectives sont organisées à
travers toute la ville. Dans le métro ultramoderne, on
croise les membres de chaque communauté, revêtus de
leurs costumes traditionnels. Little
India s'est parée de mille décorations, des myriades de
lampions ont poussé dans les rues de Chinatown. Inutile
cependant d'attendre de grandes festivités publiques,
tout se passe à la maison. Les Chinois échangent les
oranges, symbole de la prospérité. Le soir de Nouvel
An, quelques uns tirent des feux d'artifices, d'autres
multiplient les offrandes à la mémoire de leurs
ancêtres, d'autres encore font brûler les bâtonnets
d'encens. Les danses du dragon, rythmées par les
tambours, résonnent dans les échoppes de rue. Les
vaches, symbole de l'année, fleurissent partout. Les
Indiens et les Malais se réunissent de leur côté pour
de grands repas qui célèbrent la fin des quarante jours
de jeûne. Des prières collectives sont organisées à
travers toute la ville. Dans le métro ultramoderne, on
croise les membres de chaque communauté, revêtus de
leurs costumes traditionnels. |
Chinatown, le faux et les vrais. On
l'imaginait mystérieuse, grouillante et sombre. On
attendait les tatoueurs de rue, les pharmacopées  hallucinantes, les
calligraphies magiques... On se surprend à se balader
sans jamais frissonner dans un décor de mini-Disneyland
ethnique. Repeinte à neuf, joliment décorée, proprette
et aseptisée, Chinatown en a perdu toute atmosphère
romanesque. On y cherche en vain ce qui a bien pu exalter
Hemingway. Ne manque plus que le dragon payé par
l'office du tourisme pour se faire photographier avec les
six millions de touristes qui visitent chaque année la
cité-Etat. Pour retrouver l'atmosphère d'un vrai
quartier chinois, il faudra aller se perdre beaucoup plus
loin, dans les banlieues HLM de Singapour. Au bas des
blocs de béton, on trouve enfin les petits restaurants
de rue aux mets indescriptibles, les magasins aux mille
saveurs inconnues, les pharmacies surprenantes, les
têtes de poisson frites au curry, les cadavres de
chauves-souris pilés, les racines de gingembre censées
favoriser la virilité; les pancartes en mandarin sans
traduction anglaise, les vieux joueurs de majong... Enfin
au coeur, tout au coeur de Singapour. hallucinantes, les
calligraphies magiques... On se surprend à se balader
sans jamais frissonner dans un décor de mini-Disneyland
ethnique. Repeinte à neuf, joliment décorée, proprette
et aseptisée, Chinatown en a perdu toute atmosphère
romanesque. On y cherche en vain ce qui a bien pu exalter
Hemingway. Ne manque plus que le dragon payé par
l'office du tourisme pour se faire photographier avec les
six millions de touristes qui visitent chaque année la
cité-Etat. Pour retrouver l'atmosphère d'un vrai
quartier chinois, il faudra aller se perdre beaucoup plus
loin, dans les banlieues HLM de Singapour. Au bas des
blocs de béton, on trouve enfin les petits restaurants
de rue aux mets indescriptibles, les magasins aux mille
saveurs inconnues, les pharmacies surprenantes, les
têtes de poisson frites au curry, les cadavres de
chauves-souris pilés, les racines de gingembre censées
favoriser la virilité; les pancartes en mandarin sans
traduction anglaise, les vieux joueurs de majong... Enfin
au coeur, tout au coeur de Singapour. |
 |
" Shoppiiing ! " Le cri de ralliement des milliers d'adolescents singapouriens ? " Shoppiiiing ! ". La recette d'un samedi après-midi réussi ? " Shoppiiiing ! ". Le secret de la prospérité des commerçants chinois ? " Shoppiiing ! ". Bien loin d'une nécessité, plus qu'un simple passe-temps, le shopping fait désormais office d'art de vivre à Singapour. Il faut voir ces centaines de centres commerciaux arpentés fiévreusement par des centaines de milliers de consommateurs à toute heure du jour... Il faut voir ces adolescents, habillés par les grands couturiers, se balader en riant, l'éternel petit sac en plastique à la main. Qu'ont-il trouvé cette fois ? La montre à la dernière mode, le tee-shirt griffé par un créateur français, les chaussures à talons compensés qui viennent juste d'arriver de Londres ? Orchard Road, l'artère centrale de la ville, n'est qu'une succession de centres commerciaux, tous plus luxueux les uns que les autres. Cinq ou six étages à chaque fois, de véritables petites villes dans la ville : tous ont leurs restaurants, leurs food-centers, leurs bureaux d'information (essentiels pour ne pas s'y perdre), leurs climatisations, leurs coiffeurs, leurs toilettes, leurs épiceries... De quoi faire rêver un Le Corbusier, grand fana des cités totales. |  |